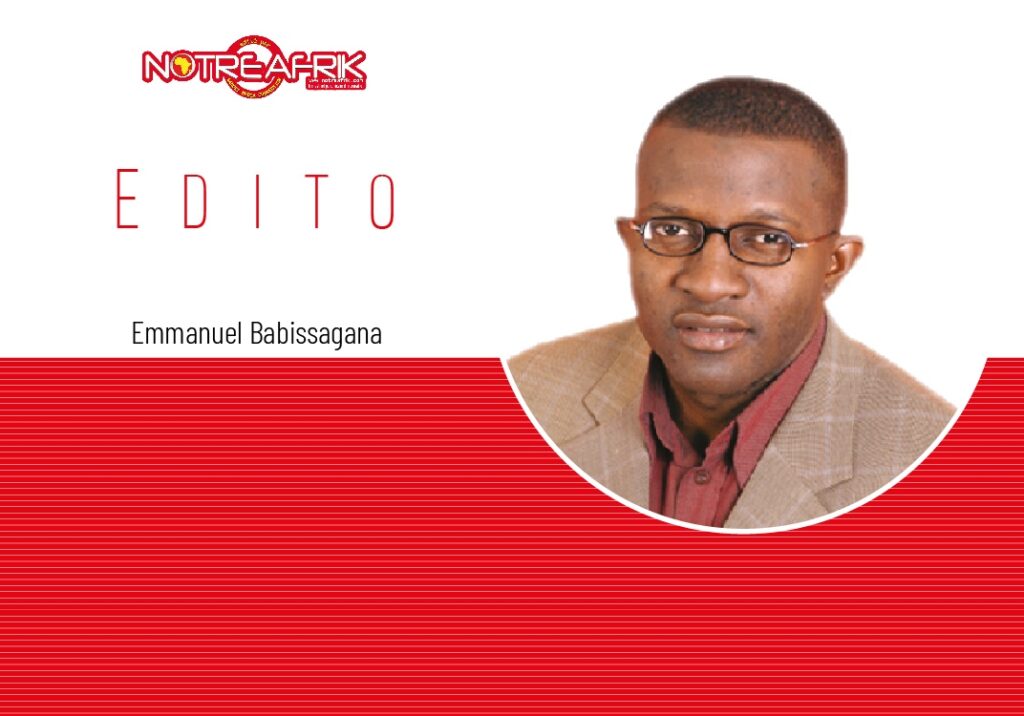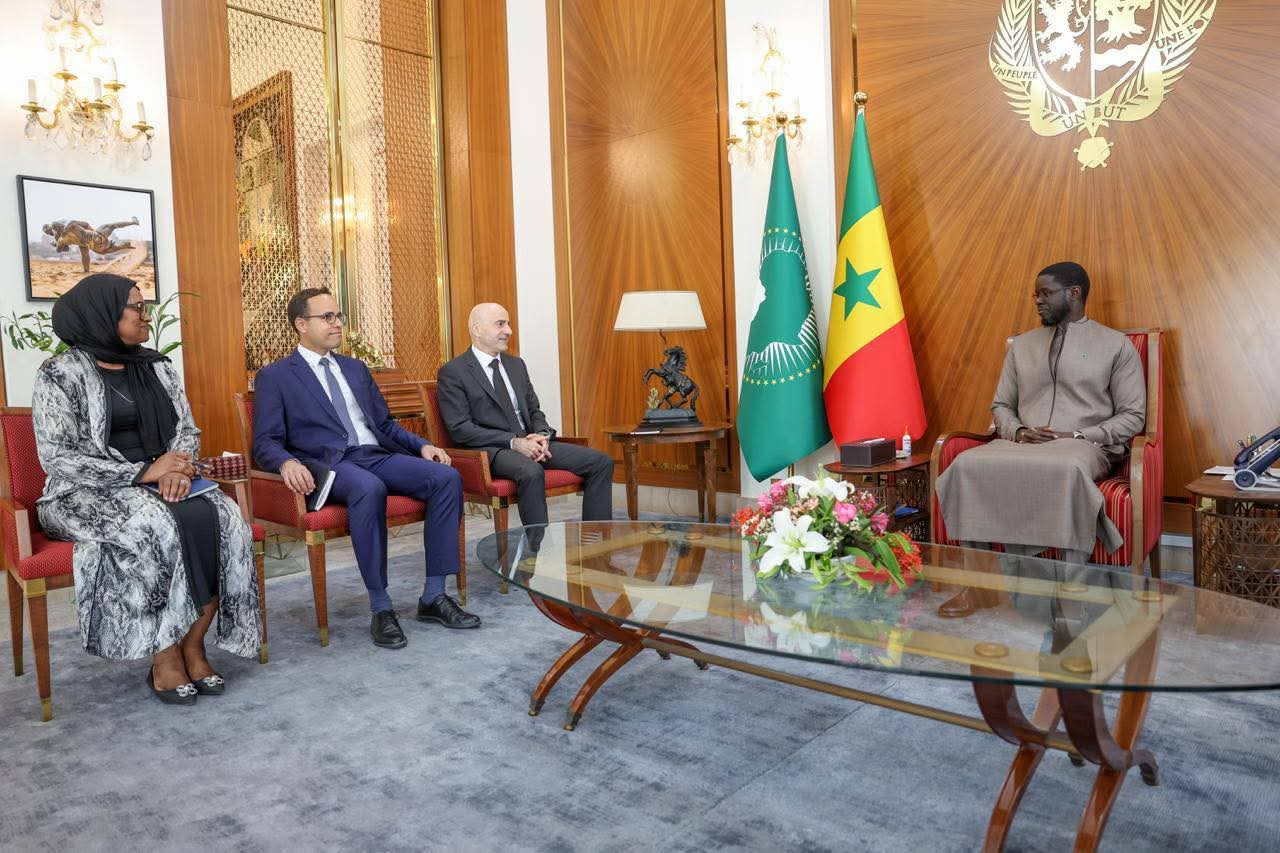Dans son édito paru dans le dernier numéro du magazine Notre Afrik en kiosque, Emmanuel Babissagana, le directeur de publication revient sur l’actualité dans cette région de l’Afrique.
Les attaques terroristes de Mansila au Burkina Faso le 11 juin dernier et les évènements qui les ont suivies ont certes relancé les spéculations quant à l’avenir du régime burkinabè et du capitaine Traoré qui le dirige ; mais plus profondément, c’est l’avenir de l’Alliance des États du Sahel (AES), portée sur les fonts baptismaux le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est plus que jamais questionné.
En guise de réponse, lors de sa récente visite au Burkina Faso, le 25 juin 2024, le président malien, le colonel Assimi Goïta, est revenu sur la question sécuritaire pour saluer les partenariats « sincères » de l’AES avec notamment la Turquie, la Russie et la Chine. Des partenariats qui, selon lui, « ont permis aux trois pays de bien s’équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes ». La tonalité du discours est la même dans les trois pays de l’AES confrontés au terrorisme qui est, toujours selon les termes du colonel, « manipulé et financé par certaines puissances étrangères ». Ce que l’AES dénonce en réalité, c’est la montée dans le sahel de cette « diplomatie de l’insécurité » ou plus exactement de l’insécurisation de territoires dotés de ressources naturelles, à des fins d’implantation de bases militaires stratégiques et de contrôle direct ou indirect de leur exploitation. C’est à ce sinistre agenda qu’elle entend officielle ment répondre, comme le rappelle la Déclaration de ce 6 juillet 2024 à Niamey, à travers laquelle les États de l’AES actent la naissance de la Confédération qui les réunit ainsi que leur retrait irrévocable de la CEDEAO.

Force est ici de constater que la persistance de groupes armés terroristes dans le sahel, malgré des décennies de partenariats sécuritaires tous azimuts, demeure pour le moins étrange. Elle alimente des questions récurrentes dont l’apparente naïveté, loin d’en atténuer la pertinence, la conforte chaque jour davantage, à la lumière du bon sens et des évidences qu’elles recouvrent ou révèlent, en creux. En effet, comment dans ce vaste désert, sans aéroport ni aérogare, peut-on se procurer autant d’armes, des milliers de motos et de voitures 4X4 neuves, pour circuler et mener des attaques en toute discrétion, des milliers de téléphones portables indétectables pour communiquer, sans être repéré par les drones et autres satellites dans la région, sans que l’on puisse retracer où ils sont achetés, les moyens de leur acheminement, le lieu de leur débarquement, etc. ?
«Force est ici de constater que la persistance de groupes armés terroristes dans le sahel, malgré des décennies de partenariats sécuritaires tous azimuts, demeure pour le moins étrange. Elle alimente des questions récurrentes dont l’apparente naïveté, loin d’en atténuer la pertinence, la conforte chaque jour davantage, à la lumière du bon sens et des évidences qu’elles recouvrent ou révèlent, en creux».
D’où viennent les millions de litres de carburant nécessaires pour alimenter ces engins dans le désert, et les pièces de rechange pour les réparer ? Enfin d’où viennent les fonds qui alimentent ces groupes ? On pourrait rallonger à souhait cette litanie de questions que se posent de nombreux Africains et autres journalistes qui s’intéressent de près à cette tragédie.

Le but n’est cependant pas d’ériger ici un mur des lamentations sur le terrorisme au sahel, mais d’en indiquer les ramifications, les raisons et les effets actuels et potentiels sur l’avenir de l’AES. Un avenir qui ne se joue pas que sur le plan sécuritaire, mais autant sur bien d’autres plans, juridique, sociopolitique, économique et diplomatique, notamment. Au plan juridique, la question de l’État de droit demeure cruciale, ce d’autant que le statut de « gouvernements de transition » fait peser une hypothèque sur la légalité et donc la pérennité de certains actes posés par les juntes. Il en est de même au plan sociopolitique, où le respect des droits et libertés fondamentales ne peut indéfiniment faire l’objet d’entorses et de restrictions, sous peine de les voir perdre l’assentiment populaire. La viabilité économique est tout aussi essentielle pour ces États enclavés, qui ont besoin d’une intense diplomatie économique pour s’assurer des débouchées et garantir leurs approvisionnements, et politique pour établir des relations pacifiques avec leurs voisins.
Lire aussi: Cedeao : un sommet pour résoudre la situation au sahel avec l’AES
L’avenir de l’AES est par conséquent suspendu à la capacité des juntes qui les dirigent à relever ces défis et à s’entendre durable ment. Historiquement, les grandes hérésies ont eu deux destins principaux. Soit elles ont « réussi » et abouti à des schismes, sans toutefois éviter l’émergence subséquente d’autres petites hérésies internes comme on le voit avec le protestantisme. Soit elles ont été vaincues, mais ont forcé la religion dominante à se réformer et à se renouveler profondément, en vue de remédier aux maux qui les avaient provoquées et d’envisager ainsi un avenir pacifié et prospère. L’avenir de l’AES se situe très probablement entre ces deux voies. Tout dépendra aussi de l’attitude de ses voisins de la CEDEAO qu’elle a choisi de quitter, selon qu’ils se comporteront comme des malandros s’évertuant à la déstabiliser au prétexte qu’elle est une menace existentielle, ou qu’ils prendront a contrario acte de ses aspirations différentes et travailleront à créer ensemble les conditions ou le cadre d’un œcuménisme politique adossé sur des aspirations émancipatrices communes. De leur choix, dé pendra donc in fine la capacité de la flamme révolutionnaire de l’AES à illuminer ou, au contraire, à embraser davantage l’avenir de l’Afrique (de l’Ouest).
Emmanuel Babissagana